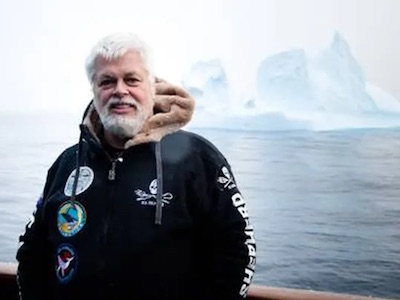L’Allemagne est enfermée dans un débat sur l’avenir de sa politique étrangère et sur la manière d’aider l’Ukraine. En France, Macron décide seul. Fait intéressant, deux cultures politiques différentes produisent les mêmes résultats politiques.
Force est de constater qu’aujourd’hui les querelles franco-allemandes ne manquent pas. Mais quand il s’agit de savoir jusqu’où soutenir l’Ukraine et comment traiter la Russie, Paris et Berlin sont à peu près d’accord. Le chancelier Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont déclaré qu’ils soutiendraient l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire » et qu’il appartenait à Kyiv de décider si et quand les négociations se poursuivraient.
Les expéditions d’armes vers l’Ukraine en provenance des deux pays sont importantes, mais compte tenu de leur taille, elles font pâle figure par rapport à la Grande-Bretagne et à certains pays d’Europe centrale et orientale. C’est parce que les armées des deux pays sont à court de ravitaillement, mais aussi parce que Berlin et Paris se soucient plus de la menace nucléaire de Moscou que de la victoire de Kiev. Par conséquent, ils restent réticents à fournir des armes « offensives ».
Enfin et surtout, dans le cadre des accords malheureux de Minsk (avec l’Ukraine et la Russie), les deux puissances estiment qu’elles doivent jouer un rôle clé dans toute architecture de sécurité européenne d’après-guerre. Tous deux continuent d’envoyer des signaux au président russe Vladimir Poutine qu’ils seraient prêts à travailler à nouveau avec lui s’il changeait de cap et mettait fin à la guerre.
« Berlin et Paris se soucient plus des menaces nucléaires de Moscou que de la victoire de Kyiv. Par conséquent, ils continuent d’être réticents à remettre des armes « offensives ». »
Si, en revanche, on regarde l’attitude de l’opinion publique face à la guerre, un tableau presque identique se dégage des deux côtés du Rhin sonde Octobre, les deux tiers des Français et des Allemands soutiennent des sanctions contre la Russie. Environ 60 % des Français et des Allemands soutiennent les livraisons d’armes et l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. En revanche, 20 % des Allemands et 16 % des Français ont encore une « bonne opinion » de la Russie.
Bien qu’il n’y ait pas de clivage franco-allemand dans la politique ukrainienne, le débat public sur cette question dans les deux pays ne pourrait pas être plus différent.
Premier débat de politique étrangère en Allemagne
La politique étrangère a rarement été un sujet majeur dans la politique allemande après 1945. En tant que centre de contrôle de la guerre froide, la République fédérale avait peu de marge de manœuvre en matière de politique étrangère. Au lieu de cela, Bonn s’est concentré sur la construction de ce qui allait devenir l’UE et sur l’enrichissement de ses citoyens et donc sur la jalousie de leurs frères et sœurs est-allemands. Au plus tard en 1989, les Allemands s’étaient habitués aux avantages d’une politique étrangère prudente tournée vers le multilatéralisme et l’économie calquée sur le modèle suisse.
La guerre du Kosovo de 1998/99 a forcé une Allemagne réunifiée à sortir de cette zone de confort pour la première fois. L’Allemagne doit-elle renoncer à son confinement militaire ? La décision de soutenir la mission de l’OTAN a marqué un tournant majeur dans le pays, qui a longtemps été la devise plus jamais la guerre (plus de guerres) avec une intervention non militaire. Mais le débat a été court. L’opération de l’OTAN a duré moins de deux mois. Très vite, la politique allemande s’est de nouveau concentrée sur des questions internes telles que la lutte contre le chômage ou la sortie du nucléaire propagée par les Verts.
La guerre de la Russie contre l’Ukraine est différente. L’Allemagne est engagée dans le plus grand débat de politique étrangère depuis des décennies alors que la guerre fait rage et que le calcul de Poutine remet en question les principes fondamentaux de la politique étrangère et économique allemande. Et parce que, contrairement à 1999 au Kosovo, le débat n’est pas que moral. Les décisions que Scholz doit prendre concernant l’Ukraine impliquent des risques et des compromis qui affectent les principaux intérêts allemands.
Dans ce débat politique, la chancelière est exposée à des critiques constantes. Les talk-shows hebdomadaires de la télévision allemande discutent sans relâche de la guerre et du rôle de l’Allemagne dans celle-ci. Faut-il durcir les sanctions et envoyer plus d’armes – et plus lourdes – à Kyiv ? Scholz devrait-il lancer une initiative pour négocier un cessez-le-feu ? L’ex-chancelière Angela Merkel est-elle responsable de la guerre ?
Non seulement lors d’un rassemblement social, mais aussi au Bundestag, Scholz est interrogé à plusieurs reprises sur l’Ukraine. De l’opposition, bien sûr, mais aussi des députés des partis de son propre gouvernement de coalition. Certains députés de cette coalition – des sociaux-démocrates issus des rangs de Scholz, des Verts et des démocrates libres pro-business – ont même rejoint l’opposition en adoptant une résolution obligeant le gouvernement à fournir à l’Ukraine des « armes lourdes ». Et le débat dépasse l’Ukraine. Comment traiter la Chine, le premier partenaire commercial de l’Allemagne, qui agit de manière de plus en plus autoritaire et est devenu le centre d’un conflit ouvert au sein de la coalition gouvernementale ?
Sans doute à tournant il a encore un long chemin à parcourir. Le mouvement est évident et la refonte de la politique étrangère allemande promise par Scholz n’a pas encore pleinement commencé. Briser les schémas de pensée enracinés est extrêmement difficile, comme le sait tout thérapeute comportemental. Mais il ne fait aucun doute que la politique et la société civile allemandes luttent contre la guerre et se battent pour les lignes directrices de la future politique étrangère allemande.
‘domaine réservé’
En revanche, en France, l’Ukraine est quasiment absente du débat politique. Aucun des alliés de Macron, pas même l’opposition, ne considère qu’il est politiquement nécessaire ou opportun de revoir l’échec de la politique russe de Macron ou de faire pression sur l’Élysée au sujet de sa politique actuelle en Ukraine. Pourquoi?
Premièrement, l’une des contradictions en France est que dans le pays dont on parle comme mode de vie, la discussion de fond sur la politique étrangère reste limitée. On ne compte plus les émissions de radio dans lesquelles politiciens et experts débattent de questions générales comme : « Quelle place la France a-t-elle dans le monde ? » ou « Macron a-t-il rendu la France plus influente ? » Les discours de Macron sont aussi disséqués et critiqués à l’envi par les journalistes et les experts. . Mais nous n’allons pas si loin.
Kyiv vouloir chars Leclerc français, mais ni l’opposition, ni les médias, ni les groupe de réflexion Ils lancent une vaste campagne pour faire pression sur Macron afin qu’il annule son veto. Les législateurs n’adoptent pas de résolutions restreignant ou obligeant Macron à voir la liste des ventes d’armes françaises à l’Ukraine, qui sont tenues secrètes.
Que Macron peut faire ce qu’il veut en politique étrangère, le soi-disant Domaine réservé (domaine réservé) du Président, ne se limite pas à sa présidence. Que Nicolas Sarkozy ait décidé de renverser le dirigeant libyen Mouammar Kadhafi en 2011, ou que François Hollande ait voulu bombarder la Syrie en 2013 à cause de l’utilisation d’armes chimiques, ou qu’il ait voulu envoyer des milliers de soldats au Sahel pour lutter contre les islamistes, le parti du président , l’opposition et les médias acceptent plus ou moins que fait accompli (affaire conclue).
De plus, la guerre en Ukraine est encore loin pour beaucoup de Français. Plus d’un million des Ukrainiens sont arrivés en Allemagne depuis le 24 février 2022. Les amis accueillent les réfugiés. Les voitures avec des plaques d’immatriculation ukrainiennes sont garées devant le supermarché local. En attendant, seuls 120 000 Ukrainiens ont opté pour la France. Il y a aussi beaucoup moins d’identification avec l’Ukraine, un pays que les Français connaissent peu. Il n’y a pas d’équivalent français de Vitali Klitschko, ancien champion de boxe et star allemande qui attire l’attention de la nation lorsqu’il plaide pour plus d’armes en allemand à la télévision.
Le cycle de l’actualité française est beaucoup plus rapide. L’espace public en Allemagne est défini par une série de débats hebdomadaires calmes à la télévision publique. En France, les chaînes d’information privées 24 heures sur 24, avec des clients sur des tabourets de bar essayant désespérément de sortir leur blague avant que l’animateur ne les interrompe, donnent le ton dans cette démocratie hyper énervée.
« Sont des tournants ? Non!’
Après tout, la guerre en Russie était sur choc Mineure pour le système politique et économique de la France. La France a une bombe atomique. Elle n’a pas à craindre la Russie, avec qui elle n’a jamais beaucoup échangé. La dépendance de la France à l’égard de la Chine reste gérable par rapport à l’Allemagne, et Paris a toujours été beaucoup plus prudent à l’idée que Pékin mette la main sur des infrastructures clés comme la 5G.
Bref, la France a moins d’erreurs à corriger. Bien sûr, la France doit se demander si baser 75 % de son approvisionnement en électricité sur une seule technologie difficile à maîtriser est aussi risqué que d’importer 55 % de son gaz d’un pays autoritaire aux dirigeants criminels. Mais si Poutine a osé lancer une invasion à grande échelle de l’Ukraine et espérer des sanctions limitées de l’UE, ce n’est pas parce que la moitié des réacteurs nucléaires français sont hors service, ou parce que Macron a déclaré que l’OTAN était « morte », mais parce qu’il pensait qu’il avait l’Allemagne dans sa poche. Après tout, Berlin a doublé son énergie russe après que le Kremlin a annexé la Crimée en 2014.
« La guerre en Russie a été un petit « choc » pour le système politique et économique français. La France a une bombe atomique. Elle ne doit pas craindre la Russie, avec qui elle n’a jamais beaucoup échangé. »
Cela pourrait aussi expliquer pourquoi Kyiv ne cherche pas à faire avancer un débat sur l’Ukraine en France. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyj a invité Merkel à Bucha, mais pas l’ex-président François Hollande. les tweets von Zelensky après que les appels téléphoniques avec Scholz soient hermétiques louanges son « ami » Macron pour son « soutien indéfectible ». L’émissaire de Kiev à Paris travaille dans les coulisses et ne critique pas la classe politique française comme l’émissaire de Kiev l’a fait à Berlin jusqu’à l’automne, bien que la classe politique française ait une tendance russophile similaire à celle de l’Allemagne.
S’il existe une preuve que l’Ukraine mérite d’adhérer à l’UE, c’est ici. Kyiv sait exactement comment jouer la politique européenne. La pression publique fonctionne dans une certaine mesure en Allemagne, où la politique étrangère est négociée entre les partenaires de la coalition et le débat est public. Dans la fière France, où c’est finalement l’un qui décide, une telle stratégie serait complètement contre-productive. Mieux vaut donc séduire son interlocuteur. Scholz et Macron peuvent apprendre beaucoup de Zelensky.
Article initialement publié en anglais dans le réseau de International Politics Quarterly.
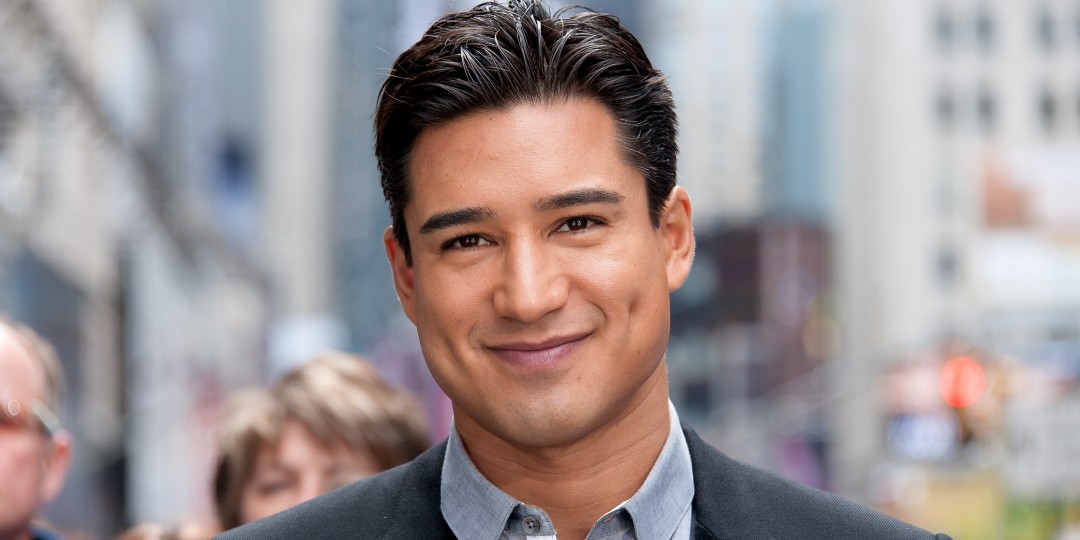
« Amateur de café d’une humilité exaspérante. Spécialiste de l’alimentation. Faiseur de troubles passionné. Expert en alcool diabolique. »